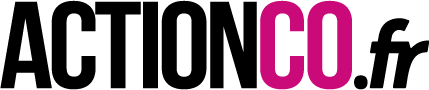Méthodes de vente illicites
Certaines méthodes de vente sont illicites, d’autres soumises à des réglementations drastiques. Parce que les tribunaux ne plaisantent pas avec la protection des consommateurs, mieux vaut faire le tour de la question avant d’inaugurer toute nouvelle approche commerciale.
Revêtir la toge d’un juriste aguerri, il convient néanmoins de réviser les méthodes de vente illicites, ou soumises à des règlements particuliers, dans l’objectif de bâtir les fondations de votre stratégie commerciale en toute légalité. La famille des méthodes de vente interdites comporte quatre grands clans : les ventes subordonnées, celles dites “boule de neige”, celles par envoi forcé et avec prime. 1. Les ventes subordonnées Le principe général édicté par l’article 30 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 détermine “qu’il est interdit de subordonner la vente d’un produit à l’achat d’une quantité imposée ou à l’achat concomitant d’un autre produit ou d’un autre service”. Il est également prohibé de “subordonner la prestation d’un service à celle d’un autre service ou à l’achat d’un produit”. Votre client se trouve ainsi protégé des écoulements de stocks intempestifs. Cette interdiction s’applique à trois méthodes de vente déterminées. La première est la vente conditionnelle. Dans ce cas, il est impossible d’obliger un client, intéressé par un produit ou un service, d’acquérir un autre produit ou un service pour obtenir ce qu’il désire. La deuxième est la vente par lot, vendre plusieurs produits différents conditionnés ensemble. Exception : la vente par lot est licite lorsque le consommateur a le choix d’acheter le lot entier ou chacun des produits contenus dans le lot séparément. Enfin, troisième pratique, la vente par quantité imposée qui, comme son nom l’indique, exige de l’acheteur qu’il acquiert une quantité minimale de produit. Toute entreprise qui enfreint la loi en pratiquant des méthodes de ventes subordonnées sera punie d’une amende (de 3 000 à 6 000 F). Ce montant peut être doublé en cas de récidive. 2. Les ventes “boules de neige” Au terme de l’article 1er de la loi du 5 novembre 1953, la définition de la vente dite “à boule de neige” est la suivante : “offrir des marchandises au public en faisant espérer à ce dernier l’obtention de ces marchandises à titre gratuit ou contre remise d’une somme inférieure à la valeur réelle du produit et en subordonnant les ventes au placement de bons ou de tickets à des tiers ou à la collecte d’adhésions ou d’inscriptions.” Par exemple, un fabricant de casseroles n’a pas le droit de dire à un client : “Je vous offrirai cette batterie de pièces ou je vous accorderai une remise si vous me trouvez cinq acheteurs.” Il lui est d’autant plus interdit de reprendre ce même discours avec l’un des cinq acheteurs trouvés par le premier. La peine encourue est sévère : 30 000 F d’amende et une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an. 3. Les ventes par envois forcés La pratique commerciale interdite consiste à envoyer à une personne, sans que celle-ci en ait fait la demande, un produit accompagné d’une lettre lui indiquant qu’il peut être accepté par lui contre le versement d’un prix fixé ou renvoyé à son expéditeur. Monnaie courante dans le début des années 90, cette pratique trouve de moins en moins d’adeptes. D’autant plus qu’elle est sanctionnée d’une amende (10 000 F maximum), doublée en cas de récidive, et que l’expéditeur encourt une peine d’emprisonnement de 10 jours à un mois. 4. Les ventes avec prime Le dernier clan des méthodes de vente prohibées, les ventes avec prime. Selon l’article 29 de l’ordonnance de 1986, “est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de service faite au consommateur et donnant droit à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services, sauf s’ils sont identiques à ceux qui ont fait l’objet de la vente ou de la prestation”. Exemple : “achetez ce vélo je vous offre une voiture”. Cet article vise à protéger les consommateurs afin qu’ils n’achètent pas des objets dont ils n’ont aucune utilité. Il existe cependant des dérogations qui permettent aux entreprises d’orchestrer des opérations promotionnelles en toute sérénité. La pratique de vente avec prime est jugée licite si le prix de la prime n’excède pas 7 % du prix de vente TTC, s’il est inférieur ou égal à 500 F, et de 30 F + 1 % s’il est supérieur à 500 F. Mais en aucun cas, le montant de la prime ne doit dépasser les 350 F TTC. Petit aparté : face à la “mobilomania”, les opérateurs de téléphonie ont conçu des abonnements avec en prime des téléphones portables. Est-ce licite puisque la valeur d’un mobile est supérieure à 350 F ? La réponse est oui, car le téléphone est indispensable à l’utilisation de l’abonnement qui a fait l’objet de la vente. Il n’est à ce titre pas considéré comme une prime. En revanche, si l’acheteur du mobile résilie son abonnement avant les douze mois pour lesquels il s’est contractuellement engagé, il devra s’acquitter de la valeur de son téléphone par mensualité. Fermeture de la parenthèse. Les infractions constatées dans le domaine des ventes avec prime sont punies par une amende dont le montant peut être doublé en cas de récidive. Le chapitre des pratiques de vente illicites clos, reste à parcourir celui des méthodes soumises à réglementation. Cette famille se scinde en plusieurs branches. 5. Les ventes réglementées Le démarchage ou la vente à domicile : si un fabricant souhaite dépêcher un vendeur au domicile ou sur le lieu de travail d’un prospect, qui en a fait la demande ou pas, dans l’objectif de lui proposer la vente ou la location d’un bien ou d’un service, il est contraint à certaines précautions. L’engagement doit faire l’objet d’un contrat écrit dont un exemplaire est remis à l’acheteur. Pour ne pas être sanctionné de nullité, ce document doit porter clairement un certain nombre de mentions : les conditions d’exécution du contrat, les modalités de paiement, etc. Le client bénéficie d’un délai de réflexion de sept jours à compter de la commande ou de l’engagement pour y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception. Les sanctions encourues par les entreprises hors-la-loi sont de deux ordres : civiles (nullité de la vente ou de la commande) ou pénales (amende et/ou emprisonnement d’un à cinq ans). Le démarchage par téléphone : bon à savoir, le législateur accorde aux personnes démarchées par téléphone une faculté de rétraction. Une pratique courante depuis l’explosion des call centers. Dans ce cas, une fois le bon de commande envoyé, le consommateur dispose de sept jours pour retourner le produit sans pénalité. Seuls les frais de retour sont à sa charge. Les ventes à distance : outre le fait d’accorder à l’acheteur un délai de sept jours à compter de la livraison d’une commande pour faire retour de ce produit, obligation est désormais faite au vendeur “d’indiquer le nom de son entreprise, ses coordonnées téléphoniques ainsi que l’adresse de son siège et/ou de l’établissement responsable de l’offre” (cf. loi du 18 janvier 1992). L’indication d’une boîte postale ne suffit pas. Les loteries avec pré-tirage : pratique courante chez les entreprises de vente à distance, ce système consiste à mener des opérations publicitaires par écrit en faisant espérer un gain au destinataire. Cette pratique n’est licite que, si et seulement si, l’entreprise n’exige du destinataire aucune contrepartie financière, aucune dépense sous quelque forme que ce soit. En cas de non respect de la loi, le montant de l’amende peut se chiffrer à 250 000 F. Par ailleurs, les ventes en solde, en liquidation, au déballage font également l’objet de réglementations particulières au même titre que la vente sur la voie publique ou la vente à crédit de biens mobiliers. Mais ce sont là des domaines beaucoup plus connus...
Les pistes à suivre Lire Pratique du droit des affaires, de G. Guéry, Groupe ESC Lyon, éd. Dunod Entreprises Codes Larcier, Droit commercial, économique et financier (vol. 4), éd. Larcier Droit économique, droit de la concurrence, de la distribution, de la consommation avec formulaires, de Gérard Cas, de Roger Bout et de Didier Ferrier, éd. Lamy, 1988 Mémento de la concurrence et de la consommation, éditions Francis Lefèbvre, nouvelle éd. 2000 P Droit de la concurrence et de la consommation, de Jean-Pierre Billon Lanfrey, éd. Génie des glaciers, 1999 Contacter Ministère de l’économie et des finances, DGCCRF, 59 bd Vincent Auriol, 75013 Paris. Tél. : 01 44 87 17 17 Les directions départementales de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes Ordre des avocats à la cour de Paris, 11 pl. Dauphine 75053 Paris Louvre RP-SP. Tél. : 01 44 32 47 37. Coordonnées des avocats spécialisés à disposition du public Remerciements particuliers à Maître Françoise Tajan et Maître Jérôme Franck pour leur concours à la rédaction de cet article.