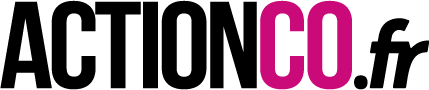Négociations commerciales : la loi Galland
La loi Galland, qui réglemente les relations entre la grande distribution et l’industrie, revient sur le devant de la scène avec une réforme devant être prochainement votée. Petit rappel des principales dispositions de cette loi et aperçu de son “relookage”.
La loi Galland du 1er juillet 1996 sur “la loyauté et l’équilibre des relations commerciales” avait pour principal objectif de rétablir des rapports sains entre les distributeurs et leurs fournisseurs. Les pratiques abusives de la grande distribution étaient en effet dénoncées depuis des années par les industriels, qui souffraient d’une pression trop forte. L’ancien ministre des Finances, Yves Galland, avait ainsi souhaité, avec sa loi, éviter cette mainmise trop forte des distributeurs en portant les réformes sur six points essentiels. 1. La facturation La facture est la référence principale de l’administration (notamment de la DGCCRF) et joue, en ce sens, un rôle prépondérant dans les négociations commerciales. C’est la base de tout, et la loi Galland a pour but de la rendre transparente. La facture doit donc être établie selon des règles strictes. Le but de la loi sur ce point précis est de clarifier la mention des ristournes et des remises figurant dessus, d’en écarter les services de coopération commerciale et de définir une date de règlement. Elle doit donc mentionner toute réduction de prix, y compris les escomptes et les paiements anticipés. Les réductions devront être directement liées à l’opération concernée. Un point essentiel : les remises pour “coopération commerciale” telles que les opérations promotionnelles ou l’octroi d’un emplacement sur tête de gondole en sont bannies. La facture définit également les critères de revente à perte. 2. La revente à perte Définir un seuil de revente à perte, c’est avant tout définir précisément le prix d’achat effectif. Celui-ci est en fait le prix unitaire figurant sur la facture majoré des taxes et du prix du transport. On le calcule à partir du prix net, duquel on déduit les remises autorisées. Concrètement, cela signifie que les grandes surfaces n’ont pas le droit, pour appâter le client, de vendre un produit en dessous de son prix de revient, cette pratique de dumping étant considérée comme préjudiciable pour le commerce de proximité. Les sanctions ont été renforcées par la loi Galland. Avant, revendre à perte était passible d’une amende de 5 000 à 100 000 francs. Aujourd’hui, elle est de 500 000 francs pour les personnes physiques, et peut atteindre 2,5 millions de francs pour les personnes morales (doublée en cas de récidive dans les 2 ans). 3. L’exception d’alignement Voici l’un des points qui fut vivement critiqué par les distributeurs lors de l’élaboration de la loi. L’exception d’alignement autorise un distributeur à baisser ses prix si ses concurrents en ont fait autant auparavant. Mais le législateur a limité cette pratique aux surfaces de vente de moins de 300 m2 commercialisant des produits alimentaires, et à celles de moins de 100 m2 spécialisées dans les produits non-alimentaires. 4. Les prix abusivement bas Afin de renforcer les sanctions encourues pour la revente à perte, une nouvelle notion a été créée : les prix abusivement bas. L’objectif est de sanctionner les pratiques consistant, pour les distributeurs, à proposer aux clients des prix très bas sur des produits fabriqués ou transformés par eux, comme la baguette à 1 ou 2 francs. La loi ne concerne cependant pas les prestations de services. Les peines encourues doivent être dissuasives : l’entreprise en infraction devra s’acquitter d’une amende représentant 5 % de son chiffre d’affaires annuel hors taxes. Attention : l’effet “anticoncurrentiel” devra être prouvé pour qu’il y ait sanction. 5. Le refus de vente La loi Galland apporte un élément inédit dans les relations entre distributeurs et fournisseurs. Elle autorise ces derniers à refuser la vente aux distributeurs. Cette pratique, très encadrée, doit permettre de rééquilibrer les rapports difficiles entre les deux entités en offrant la possibilité aux fournisseurs de réserver leurs produits aux commerçants de leur choix, selon leur stratégie. Là aussi, attention : dans certains cas, ce refus de vente peut être considéré comme une pratique discriminatoire car représentant un abus de domination économique. Dans ce cas, la responsabilité civile de l’auteur de cette pratique pourra être engagée. 6. Les pratiques abusives La loi Galland a été élaborée dans un souci d’encadrement des relations entre industriels et distributeurs, afin de combattre les abus manifestes. Le texte vise donc à éviter le référencement sans contrepartie. Il doit y avoir un accord écrit entre les deux parties établissant, par exemple, un achat minimal de la part du distributeur. De même, les parties engagent leur responsabilité pénale si elles menacent de rompre brutalement les relations commerciales dans le but d’obtenir des faveurs (prix, délais de paiement, etc.). Toute rupture de cette relation sans préavis écrit est interdite. Ces dispositions de la loi du 1er juillet 1996 ont régi toutes les négociations commerciales entre distributeurs et industriels depuis quatre ans. Mais un nombre important de syndicats et de fédérations ont, depuis, porté plainte contre les dérives que continuent d’engendrer les pratiques de certains distributeurs. Les Assises de la distribution, initiées par le gouvernement à la fin de l’été 1999, ont abouti à la mise en place d’une réforme de la loi Galland qui devrait être votée avant la fin de l’année. Cette réforme, inscrite dans le projet de loi sur la Nouvelle Régulation Économique (NRE), aura pour principale ambition de durcir les dispositions déjà en place et… de les faire respecter
Ce que prévoit la réforme Le projet de loi sur les Nouvelles Régulations Économiques (NRE) tentera de répondre à l’inefficacité des textes existants en les durcissant et en créant d’autres solutions de recours. Il prévoit, dans un premier temps, un renforcement des pouvoirs du Conseil de la concurrence et du ministre de l’Économie, lequel pourra demander la nullité des contrats et des accords illicites, et l’application de sanctions civiles à l’encontre des auteurs. Le projet de loi propose aussi l’introduction d’infractions civiles qui auront pour but d’interdire l’octroi d’avantages sans contrepartie ou disproportionnés, l’obtention de budgets de référencement sans engagement d’achat, ou l’obtention de conditions commerciales par la menace d’un “déréférencement” brutal. Cette réforme prévoit, enfin, la création d’une commission d’examen des pratiques commerciales qui pourra être saisie par les plaignants. N B : La société Euroforum organise, le 30 novembre prochain, une conférence sur la loi Galland, sa réforme et son impact sur les transactions commerciales (01 44 88 14 88).