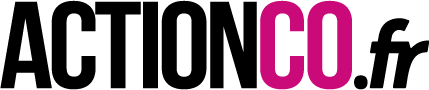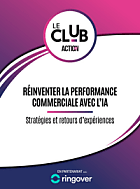DossierBusiness for Good : un modèle pour changer le monde
Les entreprises qui s'engagent font des affaires différemment. Protection environnementale, bilan carbone, solidarité... elles affichent leurs valeurs via leur raison d'être. Leur mission s'invite au coeur de l'action commerciale, quitte à modifier les pratiques et à secouer les habitudes.

Sommaire
- Quand le business à impact émerge vraiment
- Raison d'être, mais pas que
- Impact versus rentabilité
- ESS et Tech for Good
- Ces entreprises "sociales" qui cartonnent
- Préserver les distributeurs...
- ...comme les producteurs
- Fidéliser les sociétaires
- Engager les consommateurs
- Guerre des talents : ce que recherchent les jeunes
- Un engagement de A à Z
- Fournir des preuves
- Entre engagement et salaires, les jeunes diplômés ont du mal à trancher
1 Quand le business à impact émerge vraiment
La pandémie propulse l'impact social et environnemental de l'activité économique sous les feux de la rampe. Mais paradoxalement, "la crise a, à la fois, rendu la transformation des entreprises encore plus nécessaire et musclé la pression économique exercée sur les ménages, réduisant ainsi la possibilité de consacrer davantage de ressources à une consommation plus responsable", constate Bertrand Valiorgue, professeur de stratégie et gouvernance des entreprises, à l'École universitaire de management de l'Université Clermont-Auvergne.
Il est admis que les Français considèrent majoritairement (51 %) qu'une entreprise doit être utile à la société dans son ensemble (Ifop, 2016), mais le potentiel du marché reste difficile à évaluer. "D'ailleurs, c'est le citoyen qui est attentif à ces notions, pas le consommateur qui est soumis à la question du pouvoir d'achat. Seule une partie des ménages est en mesure d'absorber la hausse des prix", regrette Bertrand Valiorgue. Trois secteurs d'activité, particulièrement impactants, sont pointés du doigt : l'alimentaire, la mobilité et le logement.
2 Raison d'être, mais pas que
En 2019, la loi Pacte introduit la notion d'engagement volontaire et la reconnaissance, dans le droit français, de la notion d'intérêt social de l'entreprise. Pour rappel, les organisations peuvent faire publiquement état de leur qualité de sociétés à mission, en précisant leur raison d'être (les principes et valeurs qui orientent l'activité) et un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux, dont la conformité est contrôlée notamment par un tiers indépendant. Les actionnaires du groupe Danone ont voté l'adoption de ce nouveau statut à 99,42 % lors de l'assemblée générale qui s'est réunie le 26 juin.
S'il est trop tôt pour évaluer la sincérité des engagements et leur portée tant économique que juridique, un mouvement est enclenché dans les entreprises. "Un peu trop rapidement à mon goût", glisse Stéphane Vernac, professeur de droit privé à l'Université de Saint-Étienne, membre du CERCRID (centre de recherches critiques sur le droit), chercheur associé à Mines ParisTech, qui s'inquiète des effets d'annonce et des engagements trop généraux.
"Au niveau de Danone, tempère Bertrand Valiorgue, le niveau de communication autour de l'engagement est tel, qu'il semble impossible de tricher". D'autres organisations ont précédé la loi. Ainsi, dès 2015, Nutriset, entreprise agroalimentaire basée en Normandie, est devenue la première entreprise à objet social étendu (OSE). Son objectif ? Lutter contre la malnutrition et contribuer à l'autonomie nutritionnelle pour tous.
En 2020, elle a rejoint l'initiative des Nations Unies du Global Compact, qui vise à inciter les entreprises du monde entier à adopter une attitude socialement responsable sur la base de dix principes d'engagement en matière de droits humains, de droit du travail, d'environnement et de lutte contre la corruption. Autre exemple, le groupe de luxe Kering publie chaque année son compte de résultat environnemental (Environmental Profit & Loss Account ou "EP&L"). Les résultats de 2019 montrent qu'il est en bonne voie pour atteindre son objectif de réduction de 40 % de l'EP&L à l'horizon 2025 (par rapport à 2015).
3 Impact versus rentabilité
La tendance du business à impact est loin d'être franco-française, elle est également observée aux États-Unis et en Europe, ainsi que dans de nombreux pays occidentaux. Reste que la finance pourrait représenter un frein à son essor. L'exigence de rentabilité - contraignante - supplante l'intérêt général de l'entreprise, voire sa pérennité.
"Historiquement, la réalisation de bénéfices est apparue pour les entreprises comme le premier impact, puis progressivement une exigence de responsabilité s'est développée, une de ses premières manifestations étant la RSE. Sauf que les objectifs sont non contraignants. Ils n'autorisent pas la mise en oeuvre d'une opposition juridique et limitent l'action à des engagements très généraux", relate Stéphane Vernac.
Dès 2017, la loi sur le devoir de vigilance a exigé des grandes entreprises qu'elles établissent un plan de surveillance sur tous les impacts environnementaux et sociaux de leurs activités. Aujourd'hui, "la définition de la raison d'être incite à se tourner vers le management pour définir le sens du travail collectif. Or, certains managers le perdent au profit de l'atteinte de leurs objectifs quantitatifs", commente Stéphane Vernac.
4 ESS et Tech for Good
Si l'impact social et environnemental commence à être évalué par les organisations, l'absence de cadre commun et d'outils de mesures standardisés ralentit le processus. Deux modèles vertueux permettent aux entreprises de piloter leur impact selon une étude "Impact, un levier de création de valeur" menée par Fabernovel et France Digitale.
D'une part, les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) qui constituent les trois piliers de l'analyse extra-financière, représentent un puissant levier lorsque les grandes entreprises s'engagent au-delà des exigences réglementaires. Fabernovel cite en exemple Microsoft qui s'est engagé en début d'année, non plus seulement à la neutralité carbone, mais à des émissions de CO2 négatives d'ici 2030 sur l'ensemble de sa chaîne de valeur, entraînant probablement dans son sillon ses fournisseurs comme ses clients utilisateurs.
D'autre part, l'approche Impact by design adoptée par les entreprises qui placent l'impact au coeur de leur réacteur. C'est le cas du secteur de l'économie sociale et solidaire (ESS), qui a pris une longueur d'avance en portant des projets économiques "socialement utiles" et un ensemble de valeurs, dont la gouvernance démocratique. En France, l'ESS regroupe des coopératives, associations, fondations, mutuelles, entreprises solidaires, sociétés commerciales d'utilités sociales, etc.
Le secteur emploie près de 2,4 millions de salariés selon l'Observatoire national de l'ESS. Désormais, les acteurs de la Tech for good lui tendent la main pour opérer sa transformation digitale afin qu'elle puisse porter ses actions au-delà de l'échelle locale. C'est du moins ce que relate l'étude "Tech for Good 2019", menée par PWC et Tech'In France. Un autre axe de développement !
En chiffres
Les fonds d'investissement à la rescousse
Dix-sept fonds d'investissement représentant 400 millions d'euros mobilisables ont rejoint la communauté French Impact - bannière française pour l'économie à impact - depuis septembre 2019. Ces fonds s'engagent à consacrer une partie de leurs investissements à l'accompagnement de projets portés par des acteurs de l'écosystème French Impact. Plus globalement, le marché de l'investissement à impact en 2018 représentait 4 milliards d'euros d'encours selon l'"état des lieux du marché français de l'investissement à impact" (édition 2019, données 2018) de l'Impact Invest Lab. Cela représente une croissance de 11 % sur un an.
La quasi-totalité des secteurs d'activité sont concernés par le business for good, mais son développement se heurte aux contraintes économiques. Encadrement juridique, pont entre des mondes jusqu'ici très éloignés, voyons comment le marché se structure.
5 Ces entreprises "sociales" qui cartonnent
En ouvrant un point de vente en plein coeur de Darwin à Bordeaux (espace hybride emblématique de la transformation écologique et sociale qui réunit 50 associations et 200 entreprises), Veja, qui s'est donnée comme objectif de produire des baskets en créant une chaîne positive du producteur au consommateur, teste son interprétation du magasin du futur.
Lire aussi : Salesforce rejoint Positive AI
Atelier de cordonnerie, collecte des paires usées en vue de leur recyclage, vente à prix réduits de modèles présentant des défauts minimes, présentation de prototypes... le point de vente rassemble des activités permettant à la marque de réduire son impact sur l'environnement.
Veja, qui s'est imposée dans son secteur et a écoulé 3,5 millions de paires en 15 ans, plaide pour le zéro stock, zéro publicité, utilise du coton biologique et agroécologique, du caoutchouc d'Amazonie, des bouteilles en plastique recyclé, fabrique ses baskets au Brésil et externalise leur réception, stockage et préparation auprès d'une association d'insertion, les Ateliers Sans Frontières.
6 Préserver les distributeurs...
Le créneau des entreprises soucieuses de leur impact "social" et "environnemental" cartonne dans la mode. Faguo, créateur d'un vestiaire masculin différenciant (environ 12 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019), conjugue également style et responsabilité environnementale. Deux modèles de distribution cohabitent. "À partir de 2015, nous avons ouvert des boutiques en propre afin de booster notre notoriété, mais nous croyons fortement au modèle des revendeurs multimarques, nous souhaitons préserver ce réseau et le développer en France et à l'international", martèle Olivier Caron, responsable commercial.
Pour autant, Faguo croît à un rythme raisonné. Pour deux raisons, "plus le chiffre d'affaires augmente, plus les émissions de CO2 augmentent, or nous pilotons l'entreprise au plan financier vers sa rentabilité mais aussi vers la maîtrise de son impact carbone. La vocation de Faguo n'est pas la recherche de la croissance mais sa stabilité et sa pérennité", détaille-t-il. Cette entreprise à mission publie un bilan carbone tous les cinq ans. Une stratégie que le responsable commercial explique aux revendeurs et qui fait mouche.
"Les consommateurs achètent Faguo parce qu'ils aiment ses produits chics à l'identité outdoor urbaine. Mais pour convaincre les revendeurs, nos commerciaux expliquent notre engagement?: combien nos pièces contiennent de matières recyclées, le choix du transport par le transsibérien, en quoi le made in France ne répond pas à la problématique liée au transport des matières premières puisque, dès qu'on vend à l'international, le point central disparaît, etc.", argumente le responsable commercial.
7 ...comme les producteurs
Dans l'alimentaire, la coopérative de consommateurs C'est qui le patron??! a su faire sa place dans les rayons des supermarchés. L'idée?? Redonner le pouvoir au consommateur en réalisant collectivement sur Internet le cahier des charges d'un produit, puis le faire fabriquer et le faire commercialiser au juste prix. En 2019, 235 millions d'euros de produits ont été vendus sous cette marque.
"Le lancement de l'activité a pu se faire grâce à Carrefour qui a accepté d'accompagner des producteurs de la Bresse", rappelle Elsa Satilmis, responsable commerciale de la marque, distribuée sous forme de licence de marque. Produit emblématique?: le lait et la défense des producteurs laitiers. Les ventes des produits estampillés C'est qui le patron??! augmentent dans la majorité des enseignes fait savoir un communiqué daté du 24 juillet 2020. Sauf chez Intermarché, que la coopérative promet de remotiver. "Nous n'assistons pas aux négociations commerciales avec les distributeurs, mais les producteurs nous assurent qu'elles sont facilitées parce que nous sommes la voix des consommateurs", confie Elsa Satilmis.
Sur la plateforme, les algorithmes calculent le juste prix. "Notre objectif étant de réconcilier les trois parties, les consommateurs, les producteurs et les distributeurs", résume-t-elle. Et ça marche.
Société à mission depuis le 15 octobre 2019, Léa Nature défend un modèle de relocalisation, avec 14 unités de production basées en France. Proposer une alimentation saine au plus grand nombre, des soins bénéfiques et respectueux de l'environnement pour la beauté, la santé, la maison, favoriser l'agriculture régénératrice, préserver les ressources de la planète... Ses actions et engagements créent une dynamique positive avec ses fournisseurs, ses clients, ses consommateurs et fédèrent ses salariés.
L'entreprise milite pour une meilleure rémunération des artisans de l'alimentation, avec moins d'intermédiaires, afin de les sortir de leurs dettes et de la monoculture. Redonner aux agriculteurs le sens de leur métier - nourrir - et les moyens de le faire durablement et écologiquement, tel est l'un des objectifs de Léa Nature-Léa Compagnie Biodiversité qui emploie 1?600 salariés en 2019 et a réalisé un chiffre d'affaires de 450 millions d'euros, en progression de 11 %.
Son p-dg, Charles Kloboukoff, également président du fonds français 1 % for the Planet, fait partie des signataires d'une tribune parue dans le JDD le 27 juin avec les patrons de 76 entreprises. L'objectif?? Appeler à "s'emparer de l'urgence climatique" et soutenir la démarche et les ambitions de la Convention citoyenne pour le climat.
8 Fidéliser les sociétaires
La Maif, "l'assureur militant" devenu entreprise à mission, qui a rendu publics ses engagements, réalise un chiffre d'affaires total de 3,7 milliards d'euros en 2019. Son offre BtoB s'adresse jusqu'à présent aux associations et collectivités territoriales et ne représente que 5 % du chiffre. "Notre objectif est de doubler notre CA B2B au cours des dix prochaines années, dans la continuité de notre engagement, et d'accompagner les entreprises dans leur transition RSE et de société à mission", annonce Fabien Adam, responsable marketing et communication B2B.
D'un point de vue commercial, "les collaborateurs ne sont pas là pour vendre des contrats à tout prix, mais pour conseiller et répondre aux besoins des sociétaires", affirme-t-il. Les conseillers ne sont d'ailleurs pas rémunérés à la commission sur le volume des contrats signés, mais sont intéressés aux objectifs de la filière. "Les objectifs à la personne n'existent pas afin qu'il n'y ait pas de compétition entre les conseillers d'une part, et afin d'exclure la possibilité de conserver des sociétaires pour soi d'autre part", précise Fabien Adam.
L'entretien de cette relation de confiance contribue au développement de l'activité. "98 % des sociétaires seraient prêts à recommander la Maif, alors que le taux d'attrition ne dépasse pas 5 %", se réjouit Fabien Adam.
9 Engager les consommateurs
En boycottant le Black Friday et ses promotions XXL depuis 2017 et en fermant son site ce jour-là, la Camif clame haut et fort son engagement pour une consommation responsable. "Nous ancrons notre discours dans la réalité et cherchons à montrer qu'il existe d'autres modèles, moins gourmands en ressources, plus inclusifs", déclare Emery Jacquillat, président de l'enseigne de meubles vendus en ligne.
La Camif n'a pas attendu la loi Pacte pour donner du sens à son projet. "Nous nous sommes interrogés sur l'utilité de la Camif, ce chemin a permis de définir notre raison d'être", raconte Emery Jacquillat. Produits made in France de qualité, emplois soutenus, économie circulaire, transparence... "si nous sommes encore là, c'est que notre engagement fait sens", lâche le président de l'enseigne.
Cet axe de différenciation représente un levier de performances, de création de valeur sociale, environnementale et renforce l'ancrage local de l'entreprise. La troisième édition de la collection Camif Édition, avec son cahier des charges exigeant, en témoigne. Les clients sont au rendez-vous. "Avec la crise du Covid, nous entrons dans une phase de consommation moindre", estime Emery Jacquillat. Or, au deuxième trimestre 2020, la Camif a enregistré une croissance de 110 %. Une performance?! "La crise a libéré du pouvoir d'achat pour consommer mieux", commente le dirigeant. Le sens de l'histoire.
Témoignage
"Transformer le secteur"
Guillaume Desnoes, cofondateur d'Alenvi
Alenvi, spécialiste de l'aide à domicile pour personnes âgées, développe deux activités?: en BtoC, un accompagnement à domicile et, en BtoB, la commercialisation de formations. "Notre mission est intimement liée à la formation, car nous formons des auxiliaires de vie afin de créer un nouveau modèle d'accompagnement. Nous oeuvrons avec des établissements issus de notre écosystème pour revaloriser le métier. Nous nouons donc des relations qui finissent par devenir commerciales, c'est une conséquence heureuse", explique Guillaume Desnoes, cofondateur de l'entreprise.
La stratégie commerciale d'Alenvi permet de transformer les marques d'intérêt en ventes, mais les prospects arrivent via l'écosystème. La mission - humaniser l'accompagnement des personnes âgées et transformer le secteur -redéfinit la stratégie marketing du groupe. "Au départ, nous étions davantage focalisés sur la partie BtoC de notre activité. Mais, pour la mettre en cohérence et la soutenir, nous avons décidé de publier du contenu sur notre vision du métier, de diffuser des témoignages d'auxiliaires... Ces activités ont contribué à créer un intérêt BtoB", confie le dirigeant.
Alenvi a cocréé le "Collectif l'Humain d'abord" qui rassemble des dirigeants d'entreprises et d'associations soucieux de participer à la transformation organisationnelle dans le secteur de l'aide et du soin (Autonhome, Soignons Humains, Atelier 48, Vivat). Le collectif s'inspire de l'expérience de Buurtzorg qui a réinventé l'aide et le soin à domicile aux Pays-Bas en remettant la raison d'être au centre de l'organisation et en laissant une grande autonomie aux équipes de proximité. Depuis la crise sanitaire, la demande de formation explose car le mouvement de transformation est en marche. "Nous épousons une vague que nous avons contribué à créer", conclut Guillaume Desnoes.
Leur ADN : avoir un impact social et environnemental positif. Ce principe fort, chevillé au corps, ne les empêche pas de se développer. Paroles de dirigeants et de responsables commerciaux !
10 Guerre des talents : ce que recherchent les jeunes
Exit la Silicon Valley et ses Gafam - en partie responsables de l'impact carbone du numérique - qui ont attiré des générations de jeunes cadres. Aujourd'hui, ce qui fait tripper la jeunesse, c'est l'engagement, le bio, l'économie circulaire... "Avoir un job qui a un véritable sens et un réel impact sur l'environnement représente un plus" aux yeux de Thibaud de Broucker, diplômé d'Audencia Bachelor et actuellement en quatrième année de BBA.
Le jeune homme, âgé de 23 ans, se verrait bien en poste à l'international, dans le cadre d'une mission VIE, mais pas à n'importe quel prix ! Et se dit prêt à considérer l'engagement d'une entreprise avant de la rejoindre.
11 Un engagement de A à Z
Solenne Mior, étudiante du programme grande école de l'EM Lyon BS, réalise son stage de fin d'études chez Oé, start-up éthique et B-corp, qui travaille main dans la main avec des vignerons engagés, certifiés bios. "J'apprécie que l'entreprise soit cohérente avec un engagement de A à Z, jusque dans le choix du verre des bouteilles partiellement recyclé, les bouchons en liège naturel, etc", témoigne-t-elle.
Cette étudiante, qui se destine à une carrière commerciale dans le vin, se dit sensible à l'écologie et à la préservation de la planète. Elle estime qu'il est possible de conjuguer cette posture avec un business plus responsable. "L'intérêt que manifestent les consommateurs pour les produits bios prouve que c'est possible, le marché existe", se réjouit-elle. À 24 ans, Solenne Mior fait partie d'une génération qui "s'apprête à subir les conséquences du changement climatique. Intégrer une entreprise engagée apparaît alors comme une nécessité pour donner du sens à son travail et pour participer à la révolution écologique", dit-elle.
C'est également ce que pense Louis Robin, étudiant à la Skema BS grande école et qui appelle de ses voeux un contrat chez Danone à l'issue de son stage. "Lorsque j'ai cherché une entreprise, j'ai passé de nombreux entretiens, mais j'ai rejoint Danone parce que l'entreprise se déclare clairement responsable des enjeux environnementaux et sociétaux", affirme-t-il.
Si la grande distribution apparaît au jeune commercial comme un passage obligé - il occupe actuellement des fonctions de chef de secteur - pour développer certaines compétences, il n'en reste pas moins qu'elle doit s'aligner sur les enjeux sociaux et environnementaux. "Ce qu'elle commence à faire", glisse-t-il.
12 Fournir des preuves
Les managers peuvent reléguer leurs discours marketing aux archives. La jeune génération entend s'investir en faveur du bien commun et attend des preuves de la part de leurs futurs employeurs. Et cela commence avant l'entretien d'embauche. Éliette Verdier, doublement diplômée du programme grande école d'HEC Paris (master sustainability and social innovation) et d'AgroParisTech, qui a une expérience de stagiaire chez CDC Biodiversité, explique "analyser les offres d'emploi et les opportunités au regard des conséquences de l'action de l'organisation sur l'environnement".
Une étude des impacts qu'elle mène en prenant soin d'enquêter auprès de son entourage car, lâche-t-elle réaliste, "il est impossible de maîtriser seul tous les maillons de la chaîne". À 24 ans, la jeune femme, qui s'est créé un solide réseau dans le secteur, n'hésite pas à consulter l'avis d'enseignants, d'amis et de membre de sa famille. Surtout, confie-t-elle, "le jour de l'entretien, il faut arriver avec des questions précises afin d'évaluer - en fonction des réponses - si le management s'est lui-même déjà interrogé."
Car au fond, ce n'est pas le statut juridique de l'entreprise qui compte "mais sa volonté de participer à la préservation de l'environnement, dans le respect des droits sociaux et humains." Rejoindre par exemple une organisation qui priverait d'accès aux terres les populations indigènes sous prétexte de préserver l'environnement apparaît totalement exclu. En revanche, participer à un projet qui améliore vraiment l'existant serait envisageable, y compris si l'entreprise part de loin. Pourvu que la mission fasse sens. Avec en ligne de mire, une période d'essai considérée comme une phase décisive.
Mettre en cohérence vie privée et professionnelle, tel est l'objectif de Maxime Boniface, étudiant en MSE (mastère spécialisé entrepreneurs) à Grenoble École de Management. "J'ai un intérêt très fort pour les questions sociétales et environnementales, j'essaie donc de trouver comment améliorer l'impact dans chaque branche de ma vie", résume ce jeune homme.
Au niveau personnel, cette volonté se traduit par des lectures, de la recherche d'information, des efforts sur ses choix alimentaires, ses modes de consommation, etc. Pas question donc de lâcher prise dans la vie professionnelle. Les entreprises qui le font rêver ? L'agence française de développement (groupe AFD) qui finance et accompagne les transitions vers un monde plus durable, le groupe Ares, entreprises tremplins dont la vocation principale est de favoriser l'insertion de personnes en grande exclusion, etc. Et la création d'entreprise, pour maîtriser son engagement et être certain d'agir !
13 Entre engagement et salaires, les jeunes diplômés ont du mal à trancher
Pour donner du sens à leur vie professionnelle, les étudiants sont prêts à s'engager dans les actions sociales et environnementales de leur entreprise, voire à refuser un poste dans une entreprise qui manque d'engagement. C'est ce que confirme le baromètre "Talents : ce qu'ils attendent de leur emploi" réalisé par Ipsos pour BCG et CGE en janvier 2020.
Dans les grandes écoles, les étudiants pensent pouvoir changer les choses de l'intérieur alors que les Alumni se montrent plus partagés sur cette question. Tous montrent un attrait pour l'économie sociale et solidaire, 7 talents sur 10 aimeraient travailler ou faire un stage dans l'ESS. Et dans ce secteur, la cause environnementale recueille les faveurs des jeunes, devant l'éducation et la santé.
Mais, premier frein à l'engagement, la question du salaire est cité par près d'un tiers des Alumni. Suivent ensuite le manque de connaissance du secteur et le manque de sécurité de l'emploi. Pour autant, les Alumni intéressés par l'ESS se disent prêts à revoir leur prétention à la baisse : en moyenne, ils accepteraient une baisse de salaire de 11%.
Sensibles à la raison d'être des entreprises et à leur empreinte sur leur environnement, les jeunes qui sortent des grandes écoles de commerce recherchent des jobs porteurs de sens. Ils témoignent de leurs attentes et de leurs exigences, de leur job de demain, des boîtes qui les font rêver.
Sur le même thème
Voir tous les articles Green Business