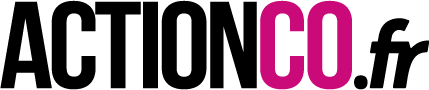[Spécial USA] "Le goût du risque est inhérent à notre culture" par Ryan Sieverson, président de Seven
Californien pure souche, Ryan Sieverson, président de Seven, a fait ses armes sur le terrain. D'abord vendeur, il a gravi les échelons dans l'industrie de la beauté jusqu'à la direction américaine du groupe français Alès... pour tout quitter il y a six mois et prendre les rênes d'une start-up.
![[Spécial USA] 'Le goût du risque est inhérent à notre culture' par Ryan Sieverson, président de Seven](https://www.actionco.fr/Assets/Img/BREVE/2016/11/311076/Special-USA-gout-risque-est-inherent-notre-culture-par-Ryan-LE.jpg)
Votre parcours montre que vous n'avez pas hésité à prendre des risques... une particularité due à vos origines américaines?
Effectivement, ma récente prise de fonction dans une startup en est la démonstration. Après plusieurs expériences au sein de grands groupes, c'est l'entreprise la plus petite pour laquelle j'aie jamais travaillé. Mais c'est aussi le challenge le plus excitant! Je crois que cette part de risque est inhérente à la vente mais aussi, c'est vrai, à notre culture. Par exemple, quand j'ai quitté mon premier employeur au bout de sept ans pour devenir vendeur dans le B to B pour une marque de produits de beauté, je prenais un risque car je n'étais rémunéré qu'à la commission, à hauteur de 10% de mon chiffre. Ce pari a été gagnant: j'ai été sacré "vendeur de l'année" dès mon premier exercice, et j'ai tout de suite gagné deux fois plus que dans mon précédent poste.
Mais j'ai découvert en travaillant pour le groupe français Alès que ce goût du risque, c'était une spécificité américaine. Ici, ce n'est pas seulement autorisé d'oser tester de nouveaux projets, c'est encouragé et valorisé. J'ai découvert qu'en France, à l'inverse, il y a de la frilosité à innover. Les managers préfèrent conserver les vieilles recettes plutôt que de se lancer dans des projets certes ambitieux, mais dont on ne peut pas garantir à 100% l'efficacité.
Cela m'a pris du temps, pour le comprendre, et mon investissement dans la chambre de commerce franco-américaine m'a aidé à y voir clair. Je pense que cela s'explique par le fait que nous avons des rapports à l'échec différents. Aux États-Unis, nous nous réjouissons des parcours de grands managers qui ont accumulé les déconvenues avant de réussir. Et lorsque nous échouons, nous passons rapidement à autre chose. En France, l'échec est beaucoup moins bien perçu, et celui qui a connu un tel épisode doit rendre des comptes pendant longtemps.
- Quelles sont les qualités pour être un bon vendeur aux États-Unis?
À mon sens, la réponse dépasse les frontières. Je dirais que ce sont d'abord des qualités humaines. Même à l'heure du digital, j'ai la conviction que les clients n'achètent qu'à des personnes qu'ils aiment bien. Bien sûr, le produit doit être performant, mais les concurrents en font souvent d'aussi corrects que les nôtres. Donc, le succès dépend beaucoup de la personnalité du vendeur : son enthousiasme, son énergie, sa force de conviction et son optimisme.
- La vente aux États-Unis est-elle plus enthousiasmante qu'ailleurs?
Nous sommes dans un pays et dans une culture où tout est possible pour quiconque se donne les moyens d'atteindre ses rêves. Le métier de vendeur permet complètement cela: en travaillant beaucoup, en s'investissant dans sa mission, on peut partir de nulle part pour écrire de belles histoires. L'american dream n'est pas une légende: même en partant du plus bas de l'échelle, on peut la gravir jusqu'aux plus beaux postes avec le mérite.
Cela veut aussi dire que l'on peut gagner beaucoup d'argent. Cela vient comme une récompense à nos efforts, à notre investissement dans notre travail. Et là encore, c'est à la fois à la culture de la vente et à la culture américaine qu'on le doit. La vente a un avantage énorme par rapport aux autres métiers: vous gagnez à hauteur de ce que vous investissez.
Cela doit nous rendre à la fois confiants mais aussi très humbles. Je me suis retrouvé récemment, dans ma start-up, devant une décision délicate. Face aux résultats décevants d'un vendeur, je suis allé avec lui sur le terrain. J'ai tout de suite perçu que le feeling ne passait pas entre lui et ses clients. Il avait beau faire des efforts pour se rendre sympathique, il manquait cette petite étincelle qui fait basculer la relation commerciale dans quelque chose de positif. J'ai pris la difficile décision de me séparer de lui, car je savais que même avec le temps, nous ne parviendrions pas à rectifier le tir. Je n'aurais rendu service à personne en le maintenant à son poste: ni à lui, ni à nous-mêmes et encore moins à nos clients.
Sur le même thème
Voir tous les articles Stratégie commerciale